La
« force d’auto-défense maritime » japonaise, héritière
de la flotte impériale totalement démantelée en 1945, est devenue
depuis 2012 la 3ème
marine militaire du monde en termes de tonnage1,
derrière ses homologues américaine et russe. Elle se retrouve
maintenant en première ligne face à une Chine qui entend s’affirmer
de plus en plus sur mer. La marine du soleil levant est aujourd’hui
à un tournant de son histoire, tiraillée entre son statut, très
contraint par la constitution japonaise, et un contexte
géostratégique tendu. Mais revenons tout d’abord sur les
circonstances de l’émergence de ce géant maritime très discret,
et comment en est-il arrivé là.
Jérôme Percheron
1945, année zéro
Le
2 septembre 1945, après 8 années d’une guerre atroce débutée
par l’invasion de la Chine et terminée dans un Japon exsangue que
les Américains s’apprêtent à envahir, le gouvernement de Tokyo
signe la capitulation de ce qu’il reste de son empire.
Les
quelques bâtiments de sa flotte de combat qui ont survécu sont
réquisitionnés par les vainqueurs : certains serviront de
cible aux essais atomiques dans le Pacifique, les autres seront
détruits. Seules quelques unités auxiliaires vont être conservées
pendant 3 ans pour rapatrier les soldats japonais disséminés en
Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.
Ses
forces militaires totalement démantelées, le Japon s’en remet
entièrement aux Etats-Unis pour assurer sa défense. Les frontières
de l’archipel sont en particulier garanties par l’U.S. Navy.
Une nouvelle constitution et un traité de paix
Les
services du général Mac Arthur, commandant en chef des troupes
d’occupation, dictent2
une nouvelle constitution au pays, dans laquelle non seulement
l’empereur n’a plus aucun pouvoir politique, mais aussi, et
surtout, le pays renonce à toute forme de droit à la guerre et à
posséder une force militaire.
L’article
9 de cette constitution, adoptée en 1947 est très clair à ce
sujet :
“Aspirant
sincèrement à une paix internationale basée sur la justice et
l'ordre, le peuple japonais renonce pour
toujours au droit
souverain d'une nation d'utiliser la force ou la menace de cette
force dans les conflits internationaux. (…) aucune
force terrestre, maritime, aérienne, ou toute autre force militaire,
ne sera possédée. Le
droit de belligérance de l'état ne sera pas reconnu. »
Le
Japon est un archipel de plus de 1000 îles, et dépend entièrement
de la mer pour ses approvisionnements en matières premières et une
bonne partie de sa nourriture (pêche). Le besoin se fait donc
rapidement sentir de surveiller les littoraux. Une agence civile de
garde-côtes, « l’agence de sécurité maritime » est
ainsi crée en 19483.
Elle hérite de quelques dragueurs de mines rescapés de la défunte
marine impériale4.
Elle permet de conserver un savoir-faire et quelques marins
expérimentés.
En
1951, à San Francisco, est enfin signé le traité de paix,
concrétisation du la capitulation de 1945, entre le Japon et ses
vainqueurs : les Etats-Unis bien sûr, mais aussi 47 de leurs
alliés (à l’exception de l’URSS et de la Chine Populaire qui
ont refusé, la guerre froide s’étant déjà imposée).
L’occupation du pays prend officiellement fin en 1952 et ce dernier
se voit autorisé à constituer une « force d’auto-défense »
non-nucléaire, non offensive, et interdite d’opérations
extérieures, à laquelle pas plus de 1% du PIB doit être consacrée.
Une lecture stricte de l’article 9 pourrait considérer cette force
comme anticonstitutionnelle, mais les Etats-Unis, fortement engagés
en Corée, sont ravis de pouvoir déléguer une partie de leurs
obligations. Ils conservent malgré tout des bases militaires
importantes sur l’archipel, notamment à Okinawa.
La création de la force maritime d’auto-défense et la guerre froide
En
1952, les Etats-Unis cèdent des patrouilleurs et des destroyers
retirés du service à l’Agence de Sécurité Maritime, dont les
effectifs enflent rapidement. Parallèlement, des chantiers navals
nippons sont remis en état et les études pour un premier destroyer
de conception nationale sont lancées…
En
1954, les « forces japonaises d’autodéfense » sont
créées, en vertu du traité de paix de 1951. Leur composante
maritime naît de la scission de la flotte gérée par l’Agence de
sécurité maritime. Cette dernière conserve l’activité
spécifique de gardes-côtes, qui reste sous administration civile et
cède les bâtiments de combat, qui passent sous contrôle du
ministère de la défense. Le « noyau » de marins
expérimentés, issus de la défunte marine impériale et conservés
par l’Agence, a donc permis cette naissance.
La
nouvelle flotte reçoit la lourde tâche d’assurer la sécurité
des frontières de l’archipel, au grand soulagement des Américains
qui peuvent repositionner leurs moyens dans le contexte de la guerre
froide :
- La VIIème flotte, basée à Yokosuka tient en respect toute velléité de la Chine ou de l’URSS, et constitue la pièce maîtresse du parapluie nucléaire américain de l’archipel, qui assure (et assure toujours) la dissuasion nucléaire du Japon, ce dernier n’ayant pas le droit de posséder d’armes nucléaires en vertu du traité de paix de 1951.
- L’île d’Okinawa, au sud, occupée jusqu’en 1972, concentre les trois-quarts des bases américaines de l’archipel et compte encore aujourd’hui plus de 20 000 soldats américains (principalement des Marines, de la Navy, et de l’U.S. A.F.)5.
En
1956, le premier navire de guerre conçu et fabriqué au Japon depuis
1945, entre en service. Il s’agit de l’Harukaze,
un destroyer à vocation anti
sous-marine, sans hélicoptère embarqué (cette technologie, à
peine mature, n’est pas encore dans les usages maritimes à
l’époque), construit par les chantiers navals Mitsubishi à
Nagasaki. Ce modèle va être constamment perfectionné et donner
naissance à 22 autres destroyers qui seront lancés jusqu’en 19786.
 |
|
Le
destroyer Harukaze,
entré en service en 1956 et retiré en 1985. Source :
http://en.wikipedia.org/wiki/Harukaze-class_destroyer
|
L’industrie
navale japonaise va devenir très active et lancer de nouveaux types
de bâtiments : destroyers lance-missiles, bâtiments de lute
anti-sous-marine équipés d’hélicoptères, sous-marins d’attaque
à propulsion classique (diesel-électrique)... Tous ces bâtiments
bénéficient de transferts de technologie américains, notamment en
ce qui concerne les radars, sonars et l’armement (canons
anti-missiles Phalanx,
missiles anti-navires Harpoon
par exemple). Dans une relative indifférence du peuple japonais, et
malgré un budget de défense plafonné à 1% du PIB, une flotte
puissante va se constituer petit à petit. Elle reste toutefois
limitée à la protection des approches maritimes du pays, sans
possibilité de projection, et axée sur un rôle défensif :
seule la destruction des sous-marins et de bâtiments de surface d’un
éventuel agresseur est recherchée.
 |
|
Le
destroyer multi-rôles Asagari,
lancé en 1986. Il est équipé du système Mk15-CIWS Phalanx
(protection rapprochée contre les missiles anti-navires) et de
missiles anti-navires Harpoon. Source :
http://www.seaforces.org/marint/Japan-Maritime-Self-Defense-Force/Destroyer/Asagiri-class.htm
|
En
effet, avec la la guerre froide, la défense de l’archipel est
principalement tournée, jusque dans les années 80, vers
l’éventualité d’une invasion soviétique par le Nord7 :
Sapporo, cinquième ville du Japon, située sur l’île
septentrionale d’Hokkaido, est à moins de 800 km de Vladivostok,
et les îles Kouriles, occupées par l’armée rouge depuis 1945,
forment un pont entre le Kamtchaka, truffé de bases militaires
soviétiques, en particulier le grand port de Petropavlosk, et la
grande île japonaise du Nord.
 |
|
Proximité
du Nord du Japon avec Vladivostok et les îles Kouriles. Source :
http://www.danube.fr/PDF/MAP/World_map_pol_2005-fr.pdf
|
L’Archipel
nippon, morcelé, avec une population et des infrastructures
principalement regroupées sur d’étroites bandes côtières, ne
dispose pratiquement pas de profondeur stratégique :
l’établissement d’une solide tête de pont ennemie se solderait
rapidement par un écroulement des défenses. Il convient donc
d’interdire l’approche de l’archipel à une flotte d’invasion,
d’où le rôle principalement de « chasseurs » des
bâtiments de la force d’auto-défense, mais aussi de
l’aéronautique navale (patrouille maritime, lutte anti-sous-marine
…).
A
partir de la fin des années 1980, ce scénario est heureusement de
moins en moins probable. Mais une nouvelle menace grandit à l’Ouest
…
Face à la Corée du Nord
Infiltrations et enlèvements
Le
régime de Pyongyang commence à infiltrer des espions au Japon
pendant la guerre froide, pour son compte ou celui de l’URSS ou de
la Chine, à l’aide de petites embarcations, mettant sur les dents
les gardes-côtes. En effet, une forte communauté originaire de
Corée vit au Japon : environ 600 000 personnes. Elle
procure, bien malgré elle, une couverture idéale à ces agents.
La
forme la plus tragique de ces actions reste l’enlèvement de
citoyens japonais, utilisés pour former les espions à la langue et
aux coutumes du pays. 17 enlèvements sont survenus entre 1977 et
1983, dont 13 ont été reconnus officiellement par la Corée du Nord
en 20028.
Ils concernaient des personnes âgées d’environ une vingtaine
d’années, la plus jeune d’entre elles étant une collégienne de
13 ans, enlevée en novembre 1977 dans la ville côtière de Niigata.
Cinq d’entre elles seulement on pu revoir le Japon, les autres sont
présumées mortes en captivité… Ce sujet continue de nos jours
d’empoisonner les relations du Japon avec la Corée du Nord. Mais
les enlèvements ne concernent pas que le Japon, des centaines de cas
suspects ont été recensés en Corée du Sud9,
cible principale des attentions de Pyongyang.
 |
|
Les
enlèvements de citoyens japonais par des nord-coréens Source :
http://factsanddetails.com/japan/cat22/sub149/item2923.html
|
La
preuve des infiltrations nord-coréennes survient en 1990 lorsqu’est
découvert, près de Mihama, une des plus grosses centrales
nucléaires du Japon, un petit bateau espion échoué10,
contenant des documents estampillés du régime nord-coréen, des
armes légères et des livres de codes de cryptage. D’autres
découvertes de bateaux-espions suivront, notamment grâce aux avions
de patrouille maritime P3-C Orion de l’aéronautique navale, mais
sans qu’ils puissent être arraisonnés à temps… Jusqu’en 2001
où, au sud de l’île de Kyushu, a eu lieu la première « bataille
navale » impliquant des forces japonaises depuis 1945 : un
chalutier armé nord-coréen, sous faux pavillon chinois, est pris en
chasse par une vingtaine de navires des gardes-côtes. Ceux-ci le
rattrapent et effectuent plusieurs tirs de semonce, auxquels le
navire-espion répond par des tirs de mitrailleuse et de roquettes,
occasionnant 3 blessés parmi les équipages japonais, qui alors
répliquent et le coulent corps et biens11.
 |
|
La
poursuite du chalutier espion nord-coréen en 2001 Source :
http://news.bbc.co.uk/olmedia/1720000/images/_1724913_boat2300ap.jpg
|
La menace balistique et les destroyers AEGIS
Bénéficiant
dans les années 1970 et 1980 de transferts de technologies
soviétiques et chinois, les nord-coréens conçoivent et fabriquent
leurs propres missiles balistiques. A partir de 1988, ils développent
le Hwasong-6, d’un portée de 900 km (exporté dans les années
1990 en Iran et au Pakistan). Il peut ainsi atteindre une partie des
côtes Ouest du Japon12.
Les recherches se poursuivent pour accroître sa portée, et des
soupçons de programme nucléaire clandestin se font jour… La
menace est sérieuse et le Japon souhaite se doter de systèmes
anti-missiles.
C’est
alors que les Etats-Unis vont leur faire cadeau d’une de leurs
technologies militaires les plus précieuses : le système AEGIS
(« bouclier » en grec). Il vient tout droit de la guerre
froide : dans les années 1960, les Américains se rendent
compte de la vulnérabilité de leurs bâtiments de surface, en
particulier de leurs porte-avions, face aux bombardiers soviétiques
équipés de missiles antinavires à longue portée. Les chasseurs
embarqués peuvent en abattre une grande partie, mais, dans le cas
d’attaques de saturation (où un très grand nombre de missiles
sont lancés sur un même objectif), certains arriveront toujours à
passer. Or il peut en suffire d’un seul pour mettre hors de combat
un porte-avions, voire annihiler un groupe aéronaval entier si le
missile est doté d’une tête nucléaire. Un système basé sur un
radar à balayage électronique très puissant, guidant
automatiquement des missiles anti-missiles lancés verticalement
(Standard Missile 1 ou SM-1), et destiné à être embarqué sur un
navire, est alors développé dans les années 70. Dès 1983, il
équipe le premier croiseur AEGIS (classe Ticonderoga)
de l’U.S. Navy.
Ces
bâtiments sont donc, dans un premier temps, destinés à la
protection des porte-avions américains. Mais on se rend compte bien
vite de potentialités du système, capable d’atteindre tout
missile balistique dans sa phase descendante. Il commence alors à
assurer un rôle de parapluie anti-missile de théâtre (au sens
« théâtre d’opérations »). C’est cette utilisation
que les Japonais vont privilégier, tout en conservant une forte
capacité anti-sous-marine et anti-aérienne, avec les destroyers
AEGIS de la classe Kongo,
basés sur leurs homologues américains de la classe Arleigh
Burke, et destinés à
constituer la colonne vertébrale de la flotte japonaise. Le premier
des 4 exemplaires entre en service en 1991, et le dernier en 1998.
Ils sont toujours utilisés et ont été rejoints dans ce rôle par
deux nouveaux destroyers de la classe Atago,
dérivés améliorés, en 2007 et 2008.
Les
nouvelles versions des missiles, SM-2 et surtout SM-3, toujours
construits par les Américains, sont capables d’atteindre des
missiles balistiques intercontinentaux dans leur phase ascendante
(avant qu’ils ne puissent se séparer en têtes multiples, ce qui
rend leur interception difficile), et même des satellites. Ce sont
ces mêmes missiles qui constituent la pièce principale du bouclier
anti-missile américain mais aussi de l’OTAN en Europe. Une
débauche de technologie pour intercepter quelques maladroits
missiles nord-coréens ? Non, car d’une part Pyongyang
perfectionne ses missiles qui atteignent une portée de plusieurs
milliers de km dans les années 2000, et d’autre part l’objectif
est aussi d’arrêter ceux d’un autre puissant voisin : la
Chine…
 |
|
29
Octobre 2010 : tir d’un missile SM-3 depuis le Kirishima
(sister-ship du Kongo),
qui intercepte avec succès un missile balistique d’exercice,
quelques minutes après sont lancement depuis Hawaï. Source :
http://www.mda.mil/global/images/system/aegis/jftm4stbd.jpg
|
Le réveil du dragon
Suite
à la libéralisation de l’économie lancée par Deng Xiaoping à
la fin des années 70, la Chine connaît depuis une croissance
économique soutenue, et, de ce fait, des besoins en énergie,
matières premières et import/export de produits toujours plus
importants. Or, ces flux transitant principalement par mer, elle se
rend compte de l’intérêt capital de sécuriser ses voies
maritimes. La mer contient également d’énormes ressources,
halieutiques, gazières, pétrolières … ce qu’un pays comme le
Japon, doté d’une zone économique exclusive13
(ZEE) 12 fois plus grande que son territoire émergé, a compris
depuis longtemps.
 |
|
Zone
économique exclusive du Japon. On voit l’intérêt de posséder
des îles éparses afin d’agrandir cette dernière. Source :
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=HER_141_0098
|
Or,
les approches maritimes de la Chine sont littéralement corsetées
par une chaîne d’îles appartenant à des états qui regardent
avec la plus grande méfiance son développement (le Japon bien sûr,
mais aussi Taïwan, Singapour, l’Indonésie, le Viêt-Nam), avec
lesquels les Etats-Unis ont plus ou moins discrètement resserrés
leurs liens.
L’amiral
chinois Liu Huaqing, qui participa à la Longue Marche aux côtés de
Mao, commandant en chef de la marine de l’Armée Populaire de
Libération de 1982 à 1988, explique alors qu’il sera nécessaire
de dominer l’espace maritime entre les côtes chinoises et cette
chaîne d’îles (voir carte ci-après), et dans un deuxième temps
de la percer pour atteindre une deuxième chaîne dont la maîtrise
lui permettrait d’accéder librement au Pacifique et d’assurer
efficacement la défense du pays. Ces objectifs doivent être
atteints à l’aide d’une marine puissante et à la pointe de la
technologie. Il initie la modernisation et l’expansion de celle-ci,
qui est, de nos jours, en terme de tonnage, à la troisième place
mondiale, ex-æquo avec le Japon, mais de nature nettement plus
offensive que la marine du soleil levant. Elle dispose en effet d’un
porte-avions (acheté non terminé à la Russie et modernisé) et en
conçoit au moins un autre. D’autre part, elle a conçu, avec
l’aide initiale de transferts de technologie russes plus ou moins
volontaires14,
ses propres équivalents des destroyers AEGIS, bien que moins
perfectionnés (destroyers Type-52C et D) et teste des missiles
balistiques capables d’atteindre des porte-avions et autres gros
navires de surface.
 |
|
Les
deux chaînes d'îles de l'amiral Liu Huaqing Source:
U.S. Naval Institute
http://www.usni.org/magazines/proceedings/2011-11/drawing-lines-se
|
Comme
ont peut le voir sur la carte, la première chaîne d’îles touche
le Japon, ce qui explique bon nombre de différends en mer de Chine
actuellement, mais la deuxième, initialement prévue d’être
atteinte vers 202015,
l’englobe ! Cette volonté d’expansion stratégique et
technologique n’est pas une simple vue de l’esprit, mais traduit
un profond sentiment chinois de ne plus avoir à subir les
humiliations que le pays a connues au cours de son histoire
contemporaine depuis les guerres de l’opium au XIXème siècle, en
passant par la signature forcée de traités injustes et de
violations de sa souveraineté (concessions étrangères, invasion
japonaise …), généralement interprétées comme venant d’un
différentiel technologique16.
Dans l’histoire récente, deux porte-avions américains ont croisé
dans le détroit Taïwan (bras de mer entre Taïwan et la Chine)
pour apaiser la crise de 1996 entre « l’Empire du milieu »
et sa « province rebelle ». Ce dernier ne le tolèrerait
plus de nos jours.
Aux avant-postes
Le
Japon doit ainsi s’apprêter à protéger ses voies
d’approvisionnements et à gérer des différends frontaliers
situés dans sa ZEE, loin des côtes du pays, tout en évitant
d’aller jusqu’à l’irréparable avec une Chine qui reste sa
partenaire économique fondamentale. C’est le cas par exemple des
îles Senkaku/Diaoyutai (respectivement nom japonais / nom chinois),
revendiquées par Pékin (et Taiwan), mais sous administration
japonaise, où de fréquents accrochages entre garde-côtes et
navires chinois ont lieu. Autre exemple, bien que la situation soit
moins tendue : Les îles Kouriles, anciennes possessions
japonaises, occupées par l’Union Soviétique en 1945 et passées
ensuite sous l’autorité de la Fédération de Russie, puissance
maritime (ré-)émergente dans la région. Le Japon considère comme
une menace potentielle leur proximité relative avec l’île
d’Hokkaido. Cette menace pourrait être neutralisée par une
maitrise de leur espace maritime.
Il
ne s’agit donc plus de défendre les approches immédiates de
l’archipel, mais bien d’assurer une présence dissuasive loin de
celui-ci. Pour que cette présence soit crédible, il faut qu’elle
montre que la force peut être utilisée, et ce, avec efficacité.
Pour cela, il est nécessaire d’avoir des moyens importants
capables de stationner longtemps dans une zone éloignée et d’en
interdire le passage : c’est ce qu’on appelle une stratégie
de « déni d’accès » ou d’ «interdiction ».
La meilleure arme pour cela, hors zones littorales, est le sous-marin
d’attaque. Ce dernier, difficile à détecter et d’autant plus
dangereux s’il est capable de rester longtemps en plongée, est
très efficace contre les bâtiments de surface. Son emploi est en
revanche beaucoup plus délicat pour contrer ses homologues adverses.
Le moyen le plus flexible pour la « chasse aux sous-marins »
reste l’hélicoptère ou l’avion de patrouille maritime, par sa
capacité à passer rapidement de la détection à l’attaque, par
la variété des équipements de détection qu’il emploie (barrages
de bouées acoustiques, détection infrarouge ou électromagnétique)
et surtout l’impossibilité pour sa cible de répliquer17.
Pour toutes ces raisons, la marine japonaise va se doter de nouveaux
types de bâtiments : les sous-marins d’attaque à propulsion
anaérobie ou AIP (Air Independant Propulsion) et les
porte-hélicoptères de lutte anti-sous-marine.
Les sous-marins
 |
|
L'Hakuryu,
troisième sous-marin de la classe Soryu,
en visite à Pearl Harbor en février 2013 Source :
http://www.enderi.fr/Tractations-sous-marines_a233.html
|
Au
début des années 2000, le Japon possédait déjà l’une des
flottes de sous-marins d’attaque les plus importantes du monde (18
unités), et certainement les sous-marins classiques (propulsion
diesel –électrique) les plus perfectionnés et automatisés, grâce
à des industries de défense à la pointe de la technologie et
affranchies du soutien américain. Vu son histoire contemporaine, on
peut comprendre que la Japon renonce à utiliser l’énergie
nucléaire dans le domaine militaire. Il n’est donc pas question
d’envisager de construire des sous-marins à propulsion nucléaire.
Pour augmenter le temps de présence des submersibles et leur
furtivité sonore, Kawasaki et Mitshubishi Heavy Industries vont
ajouter à la propulsion classique, dans les nouveaux sous-marins de
la classe Soryu, la propulsion anaérobie, en l’espèce le système
suédois Kockum basé sur le principe du moteur de Stirling18 :
c’est un gaz en circuit fermé et non le produit d’une combustion
interne qui assure la force de travail, en suivant un cycle chauffage
/ détente / refroidissement / compression. 4 de ces sous-marins, les
plus gros (4200 t) construits au Japon depuis la 2ème
guerre mondiale, sont entrés en service entre 2009 et 2013, portant
l’effectif sous-marin japonais à 22 unités, et 5 autres sont
prévus ou déjà en construction, surclassant largement leurs
homologues chinois. L’Australie, autre puissance émergente de la
région, toute aussi inquiète de l’expansion chinoise, s’est
même montrée intéressée par l’acquisition de ces sous-marins,
posant la délicate question de l’exportation d’armes par Tokyo,
jusqu’alors prohibée par l’interprétation stricte de la
constitution.
Les porte-hélicoptères
Dès
2001, la décision est prise de mettre en construction 2 grands
porte-hélicoptères afin de renforcer le parc existant de navires de
même type mais aux dimensions modestes (classe Shirane
de 1980 et Osumi
de la fin des années 90) et ainsi de faire face aux nouveaux défis
de protection de la ZEE. Ce sont les « destroyers
porte-hélicoptères » de la classe Hyuga. Qu’on ne s’y
trompe pas, ils n’ont rien d’un simple destroyer et l’appellation
est avant tout politique, pour ne pas donner l’impression de
contourner la constitution. Pouvant opérer jusqu’à 11
hélicoptères et munis d’un radier19
leur permettant des opérations d’assaut amphibie, ils peuvent
servir de navires amiraux lors d’opérations de grande ampleur. Ce
sont les plus gros navires militaires construits par le Japon depuis
la seconde guerre mondiale. Ils sont assez proches en dimensions et
en capacités de leurs équivalents français, les BPC de classe
Mistral.
Le Hyuga
et son sister-ship, le l’Ise,
entrent en service respectivement en 2009 et 2011.
 |
|
Le
porte-hélicoptères Hyuga,
survolé par les Sea
Hawks
de son escadron de lutte anti-sous-marine Source :
wikipedia commons
|
Mais
la course aux armements est loin d’être terminée. En 2013 a lieu
un évènement qui va pousser la Chine a émettre des protestations
officielles. Le record du plus gros navire de guerre japonais lancé
depuis la seconde guerre mondiale est battu par le nouveau
« destroyer porte-hélicoptères » Izumo.
Sorte de version agrandie des Hyuga,
sa longueur est à quelques mètres près celle du porte-avions
français Charles de Gaulle.
Ses 16 hélicoptères (ce qui représente une capacité de lutte
anti-sous-marine considérable) sont à l’aise dans ses immenses
hangars. Un deuxième bâtiment de cette classe est déjà en
construction. Comme pour la classe Hyuga,
ces navires reprennent le nom d’anciens cuirassés de la flotte
impériale, ce qui ajoute à l’irritation de Pékin. Fait
apparemment anodin mais à la signification très lourde : il
s’est écoulé seulement 19 mois entre la pose de la quille de
l’Izumo
et son lancement, ce qui est une performance rare en temps de paix
pour des chantiers navals militaires. Le Japon a voulu ainsi monter
que son complexe militaro-industriel était prêt, s’il le fallait,
à réagir et à monter en puissance très vite. La Chine y voit un
« porte-avions déguisé » et donc émet des doutes sur
les intentions pacifistes prônées officiellement par le Japon. Il
est vrai qu’il pourrait, avec l’ajout d’un tremplin, mettre en
œuvre des chasseurs à décollage/atterrissage court/vertical F-35B,
mais cette version du F-35 n’est actuellement pas commandée par
Tokyo. Un tel navire permet d’aller au-delà d’une stratégie de
« déni d’accès » pour permettre une stratégie plus
ambitieuse de « contrôle maritime »20,
c'est-à-dire surveiller et maîtriser, dans le temps long, un espace
maritime beaucoup plus étendu et le réserver à son usage
personnel. C’est par exemple une telle stratégie de contrôle qui
a permis finalement à la Royal Navy de s’opposer victorieusement à
la stratégie de déni d’accès des sous-marins de la Kriegsmarine,
pendant les deux guerres mondiales.
 |
| Le "destroyer porte-hélociptères" Izumo, lors de son lancement en 2013. Source http://snafu-solomon.blogspot. |
La face cachée du soleil levant
Le
grand public japonais commence à prendre conscience de la
réémergence d’un complexe militaro-industriel. Le désengagement
progressif des Etats-Unis dans la défense de l’archipel depuis la
fin de la guerre froide et la pauvreté de ce dernier en termes de
ressources naturelles n’offrent pas d’autre alternative à Tokyo
que de réaliser un grand effort pour conserver la maîtrise de ses
voies maritimes et de sa ZEE. Cela nécessite de disposer d’une
marine à l’allonge suffisante pour les protéger. C’est aussi
dans l’intérêt du Japon, lui permettant ainsi d’acquérir une
autonomie stratégique de plus en plus grande. Mais ce réarmement,
car il faut bien l’appeler ainsi, pose le problème de l’écart
de plus en plus criant entre les capacités militaires réelles du
pays et sa constitution pacifiste, complétée par le traité de
1951. D’autre part, pour financer cet effort dans un pays
vieillissant où l’économie stagne plus ou moins depuis le début
des années 90, l’exportation du matériel militaire (les
sous-marins à l’Australie par exemple) serait la bienvenue,
augmentant là aussi l’écart par rapport aux textes …
Aussi,
les gouvernements successifs préparent l’opinion publique, encore
très attachée au pacifisme, à ce que l’idée de modifier la
constitution ne soit plus considérée comme folle… Pour parer au
plus pressé, Tokyo a pris, avec la bénédiction des Etats-Unis,
deux décisions d’une portée très importante en Juillet 2014 : la
levée de l’interdiction d’exporter du matériel militaire et la
possibilité d’engager les forces d’autodéfense dans des
opérations de combat autres que celles liées à la défense
nationale21.
L’idée d’une armée « strictement défensive »
n’ayant pas de fondements réels, les masques tombent et le
« pacifisme d’état » japonais n’est dorénavant plus
qu’une façade…
Aux
yeux du gouvernement japonais, ce processus est amplement justifié
par la différence de traitement que Pékin réserve à ses voisins
de la Mer de Chine. Autant elle prend pour le moment des gants avec
le Japon, autant sa politique est nettement plus agressive avec des
nations plus faibles. C’est le cas de l’Inde, mais aussi du
Vietnam, par exemple, qui s’est vu envahir manu-militari une partie
de ses îles Paracels en 1974, et Spratly en 1988, riches en pétrole.
Le cas de Taïwan est emblématique. La « province rebelle »,
pour qui les accrochages militaires avec sa grande sœur continentale
ne sont pas une abstraction, bénéficiait encore il y quelques
années, grâce à l’aide américaine, d’une supériorité
aérienne qui garantissait sa marge de manœuvre. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui suite à la rapide montée en puissance de la
marine et de l’aviation chinoises. Or, les Etats-Unis se sont
récemment opposés à l’acquisition par Taipei de matériel
militaire dernier cri, de peur de froisser Pékin qui avait haussé
le ton… Ce dernier point a agi comme un électrochoc au Japon, qui
l’a vu comme ce qui pourrait lui arriver s’il ne poursuivait pas
ses efforts. Si le soutien américain ne lui est plus automatiquement
acquis, vers qui pourrait se tourner Taïwan pour éviter une
« finlandisation » par la Chine ? Vers la seule
puissance militaire capable de tenir tête à la Chine actuellement
dans la région : le Japon. Ce rapprochement est déjà
discrètement en cours22.
Ce serait un retournement dont l’histoire a le secret, sachant que
le pays du soleil levant l’a occupée de 1895 à 1945.
Conclusion
La
puissante flotte japonaise, née de la volonté américaine, est
taillée pour un rôle régional. Elle n’est pas capable
actuellement de se projeter à l’autre bout du monde pour des
opérations offensives comme peuvent le faire ses homologues
américaine, britannique ou française. Elle est cependant un
adversaire redoutable pour tout agresseur, excellant dans la lutte
anti-sous-marine. Son développement soutenu ces dernières années
la rend largement capable de défendre sa ZEE, et elle possède le
potentiel pour grandir encore. En effet, il ne suffit pas de posséder
des navires pour faire une flotte de combat efficace, mais de
combiner intelligemment les facteurs suivants :
- Un complexe militaro-industriel solide : seule garantie de s’affranchir d’ingérence extérieure dans la conception, la fabrication et l’emploi des navires (ce qui n’exclut pas des coopérations, bien au contraire), de pouvoir rapidement monter en puissance en cas de conflit prolongé, et tout simplement d’assurer soi-même la maintenance des navires. Le Japon excelle en ces domaines, et l’a prouvé dans la rapidité de construction du porte-hélicoptères Izumo.
- Des équipages expérimentés et entraînés : c’est une des marines au monde qui accorde le plus de moyens à la formation.
- Une doctrine d’emploi basée sur une étude claire des besoins et des menaces, ainsi que des matériels efficaces adaptés à la doctrine.
Cette
alchimie est difficile et longue à émerger, et la caractéristique
de nations ayant une longue expérience maritime, ce qui est le cas
du Japon, qui maîtrise parfaitement ces critères.
Toutefois,
bien qu’il n’ait pas vraiment le choix, son opposition frontale à
l’expansion stratégique chinoise ne peut amener à moyen terme
qu’à une aggravation des tensions. Or, si la Chine a une
démographie et une puissance économique lui permettant de prendre
tout son temps, ce n’est pas le cas du Japon, qui a du mal à se
sortir d’une crise économique larvée, ne possède aucune
ressource naturelle dans l’archipel lui-même et affiche une la
natalité de plus en plus faible.
Bibliographie
Bernard
Prézlin, Flottes de combat 2013,
Editions Ouest France, 2013
Céline
Pajon, Comprendre la
problématique des bases militaires américaines à Okinawa,
IFRI, Paris, Juin 2010
Jun
NOHARA, Changement de
l’environnement maritime en Extrème-Orient : La force
d’autodéfense japonaise,
Centre d’Etudes Supérieures de la Marine, 2011
William
C. Triplett, How a Nuclear North Korea Threatens America, Regenery
Publishing, Washington D.C., 2004, p. 114
Windy
Marty, L’importance de la lutte anti-sous-marine au XXIè siècle,
Centre d’études supérieures de la Marine, 2011
Julian
S. Corbett, Principes de
stratégie maritime, Economica,
Paris, 1993
Notes
Notes
1
D’après : Bernard Prézlin, Flottes
de combat 2013, Editions Ouest
France, 2013.
2
Morris
I.,
L'évolution
politique du Japon d'après guerre.
In: Politique étrangère N°3 - 1956 - 21e année p. 326
3
http://www.kaiho.mlit.go.jp/e/pamphlet.pdf
4
All
ships of Japan Coast Guard 1948–2003.
In : Monthly Ships of the World N° 613, Kaijinsha, Tokyo, 2003.
5
Céline Pajon, Comprendre la
problématique des bases militaires américaines à Okinawa,
IFRI, Paris, Juin 2010.
6
http://www.helis.com/database/sys/259_Harukaze_class/
7
Jun NOHARA, Changement de
l’environnement maritime en Extrème-Orient : La force
d’autodéfense japonaise,
Centre d’Etudes Supérieures de la Marine, 2011.
8
LeFigaro.fr,
9 Juillet 2014 :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/09/97001-20140709FILWWW00431-pyongyang-revele-30-noms-de-japonais-enleves.php
9
AsiaTimes online,
26 Février 2005 :
http://www.atimes.com/atimes/Korea/GB26Dg01.html
10
William C. Triplett, How a Nuclear North Korea Threatens America,
Regenery Publishing, Washington D.C., 2004, p. 114
11
BBC News, 25 décembre 2001 :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1727867.stm
12
Edouard Pflimlin, Le programme
balistique nord-coréen : quelles menaces ?,
LeMonde.fr, 20 avril 2012 :
http://www.lemonde.fr/international/article/2012/04/06/le-programme-balistique-nord-coreen-quelles-menaces_1681516_3210.html
13
Zone économique exclusive : d’après le droit de la mer, il
s’agit d’un espace maritime sur lequel un état côtier exerce
des droits souverains en matière d’exploration et d’usage des
ressources.
14
La Chine a profité, dans les années 90, de la situation
désastreuse des anciennes républiques d’URSS pour acquérir du
matériel moderne à bas prix, l’analyser et ainsi combler son
retard
15
Jun NOHARA, Changement de
l’environnement maritime en Extrème-Orient : La force
d’autodéfense japonaise,
Centre d’Etudes Supérieures de la Marine, 2011
16
Guilhen Penent, Défense et
Sécurité Internationale
n°108, DSI Presse, novembre 2014
17
Windy Marty, L’importance de la lutte anti-sous-marine au XXIè
siècle, Centre d’études supérieures de la Marine, 2011, p. 25
18
De l’ingénieur anglais Robert Stirling qui en a élaboré les
principes des 1816, confronté aux premières chaudières à vapeur
qui avaient tendance à exploser.
19
Hangar immergeable permettant la mise à l’eau de navires de
débarquement
20
L’historien et stratège maritime britannique Julian Corbett
(1854-1922) est un penseur majeur de la stratégie maritime. Dans
son ouvrage le plus célèbre, Some
Principles of Maritime Strategy,
il est le premier à théoriser et séparer les stratégies de déni
d’accès et de contrôle.
21
Défense et sécurité
internationale, n°108,
Octobre-Novembre 2014, p.24
22
Ibid., p. 69


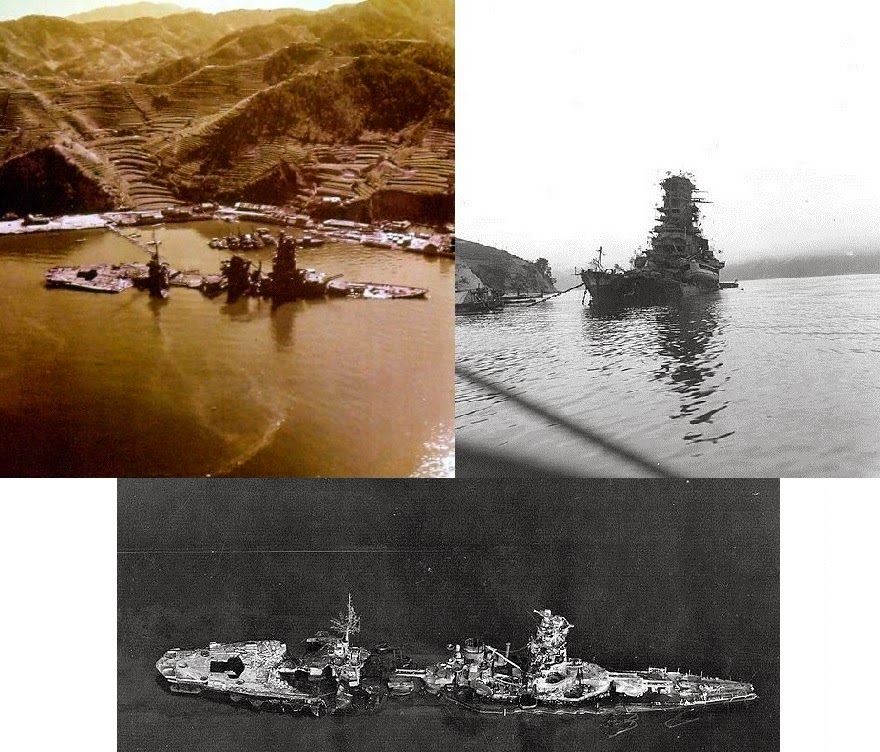



Merci pour cet article, mais attention l'image de l'Izumo et de l'Hyuga côte à côte est un fake photoshop grossier.
RépondreSupprimerImage enlevée, merci beaucoup de nous l'avoir signalée.
SupprimerToutes mes excuses pour ce fake qui a échappé à ma vigilance. J'ai refourni une nouvelle photo. Merci de l'avoir signalé.
SupprimerL'auteur.